La 18ème édition du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg s’est déroulée entre le 26 septembre et le 5 octobre 2025, toujours aussi accueillante et riche en découvertes. Cette année, Alexandre Aja (Haute Tension, La Colline a des yeux, Piranha 3D, Crawl…) a été un président du jury très impliqué, trouvant le temps, entre les dix films présentés en compétition, de donner une masterclass et de présenter chaque film de la rétrospective qui lui était consacré. L’autre rétrospective rassemblait un beau palmarès de dystopies cinématographiques sur le thème du régime totalitaire, avec en point d’orgue l’œuvre de George Orwell, qui n’en finit malheureusement pas de résonner dans le contexte international actuel. Quelques chanceux ont pu profiter d’une projection spéciale de l’inimitable Freaks de Tod Browing sous un chapiteau de cirque, tandis que d’autres se bidonnaient devant la nuit excentrique rituelle ou se retrouvaient devant une bonne bière dans le consacré Village du Festival sur la place Saint Thomas. Le FEFFS était cette année encore sur le pont pour dénicher des avant-premières sur les films fantastiques attendus et de belles nouveautés qui sortent du lot. Avant de faire le tour d’une poignée de ces films, on ne peut que remercier les programmateurs et bénévoles pour continuer à nous offrir un festival qui mérite vraiment cette appellation.
Big Gun

La plus belle surprise de ce FEFFS n’est pas un film fantastique, mais un polar aussi attachant que percutant présenté dans la compétition Crossovers. Luger suit deux brutes de bas étage qui interviennent pour le compte d’une avocate véreuse pour régler des affaires à leur façon. Leur dernière mission de retrouver la voiture volée d’un client les conduit dans un imbroglio dont l’enjeu est une relique de la seconde guerre mondiale. Face à des adversaires coriaces et sans pitié, ils vivront les heures les plus angoissantes de leur vie.

Le ton de Luger est d’entrée de jeu outrancier et grotesque, à quelques encablures des films d’un Alex de la Iglesia, et il conservera sur sa durée la même propension que le réalisateur du Jour de la Bête à nous mettre au milieu de personnages moralement irrécupérables, sans véritable parangon de moralité auquel s’identifier. Le réalisateur espagnol Bruno Martín (également acteur dans le film) ne lésine pas sur la violence qui fait mal et il connaît ses classiques. Certains pourront voir dans cette spirale infernale dans le monde du crime local des réminiscences de Snatch (sans le clinquant), quelques séquences Tarantinesques bien dialoguées, une vibe proche du Pusher de Nicolas Winding Refn (dans son authenticité) et un peu de La Haine de Matthieu Kassovitz. Luger s’épanouit dans son espace-temps confiné, offrant une confrontation qui nous extirpe peu à peu de notre distance amusée de spectateur et de toutes ses références pour plonger dans la dynamique de son duo, interprété par les talentueux David Sainz et Mario Mayo. La fin est touchante et elle tire dans le mille. Une belle plus-value à tous les niveaux pour un film au budget plutôt modeste qui décroche à juste titre le grand prix de cette section Crossover.
Royal Canin

Rompu à des années de found-footages foireux réactivés par le pénible Paranormal Activity et ses rejetons de l’enfer, l’horrorophile qui a de la bouteille a pris l’habitude de se méfier des films à concept. Il aura pourtant fallu la bouille irrésistible d’un retriever nommé indy pour faire baisser sa garde. Depuis ses apparitions sur le tapis rouge de la première de Good Boy aux Etats-Unis aux côtés de son maître / réalisateur Ben Leonberg, Indy devient une star des réseaux sociaux qui vantent à tout va le talent du toutou craquant dans ce premier film d’épouvante entièrement tourné du point de vue d’un chien. Et sur ce point, il n’y a vraiment rien à dire. En plus d’être un bon chien qui assure à merveille la promo de son maître, Indy crève l’écran. Il porte chaque scène de Good Boy par son regard intense, son énergie et sa présence magnétique, icônisée par un maître qui sait la chance qu’il a.

Mais un adorable canin, ça ne suffit pas à porter un film d’horreur. Good Boy décrit basiquement la confrontation du chien à des évènements paranormaux qui touchent la maison de famille dans laquelle il vient d’élire domicile avec son maître. Nous comprenons que ces évènements pourraient avoir un rapport avec la maladie de celui-ci qui ne fait qu’empirer en même temps que sa dépression. Indy a des visions de spectres hantant la maison. Est-ce un fantôme familial malveillant ? Est-ce une présence démoniaque ? Est-ce une perception de la mort en personne venue chercher son maître ? Cette dernière option paraît être la plus probable, mais elle n’explique pas complètement les cauchemars d’Indy et la hantise du grand-père, dernier propriétaire de la maison. Il est toujours bon de laisser la place à l’imagination et au non-dit dans un film d’horreur, mais le réalisateur scénariste évite trop les partis pris, qu’ils soient dramatiques ou purement narratifs. Il introduit de belles pistes qui auraient pu conduire à des moments forts pour les étouffer constamment dans l’œuf, si bien que son film ne démarre jamais vraiment, ni ne fait vraiment peur. Sur ces 1h12, Good Boy aurait pu à tout moment basculer vers un grand film qui fait date. C’est finalement une belle déception qui ne mérite pas son Grand Prix. Le film ne sortira en salles que les 10 et 11 octobre prochain, pour finir ensuite dans le catalogue de la plateforme Shadowz.
Magie Champêtre

Présenté en compétition, Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski coche beaucoup de bonnes cases. La réalisatrice plante avec brio son décor : L’enjeu pour son héroïne qui est d’aller étudier en ville, le poids des traditions dans sa famille d’expatriés polonais qui l’assigne à un rôle, le poids de la communauté rurale, le pouvoir dormant de convoquer les esprits qu’elle a hérité de sa mère, le retour d’une enfant de la bourgade (Roxane Mesquida, vénéneuse) détestée mais objet de toutes les convoitises. Française d’origine polonaise, la réalisatrice apporte une description intéressante de cette famille de fermiers polonais très bien intégrée à cette bourgade de la France profonde, guidée par un patriarche bienveillant, mais prisonnier des traditions. La première moitié du film est remarquable de par son authenticité et sa montée de la tension, allant voguer du côté des drames ruraux français des années 70 et 80 tout en distillant efficacement son background fantastique. Elle culmine dans un repas de mariage polonais qui s’achève dans une virée nocturne angoissante que n’aurait pas reniée Fabrice Du Welz.

Julia Kowalski excelle à faire monter la tension en entrelaçant les éléments de vie locale et le conflit intérieur de son héroïne. Elle laisse à la jeune Maria Wrobel le challenge d’être le référent des spectateurs tout en étant elle-même une menace incontrôlable, un rôle que la jeune actrice tient avec les honneurs dans une dualité entre mutisme de convenance (préconisée par le père) et déchaînement furieux (appelé par la mère). Le film se perd un peu sur sa dernière partie par manque de clarté et par quelques maladresses. Mais il a pour lui de ne pas sacrifier au moralisme pour emporter une morale plus animale qui va très bien avec son cadre. Son final n’est pas moins qu’une prise de pouvoir en bonne et due forme sur son destin et sur son corps, et une prise de pouvoir n’est jamais quelque chose de propre. Que ma volonté soit faite est un des films de ce festival qui grandit le mieux après visionnage. Il sortira le 3 décembre en salles.
L’âme des Guerrières

Egalement présenté en compétition, Màrama, le premier long-métrage du néo-zélandais Taratoa Stoppard est aussi une histoire d’émancipation, mais dans un univers totalement différent. Nous sommes en 1859, dans l’Angleterre Victorienne qui est alors au top de son règne sur ses colonies. Une jeune femme maori nommée Màrama (la très convaincante Ariana Osborne) se rend dans le Yorskshire pour en savoir plus sur son passé. Elle est accueillie dans un manoir par le maître des lieux (Toby « Black Sails » Stephens), ancien baleinier qui a fait fortune dans les terres de son enfance. Il l’engage comme gouvernante pour s’occuper de sa petite-fille, orpheline de mère et affublée d’un père alcoolique. Alors que le propriétaire des lieux devient de plus en plus entreprenant, des visions préviennent notre héroïne d’un péril imminent et d’un lien qu’elle aurait avec la mère de la fillette, morte dans des circonstances pour le moins étranges.

Ayant lieu pour une grande partie dans un manoir victorien peuplé de secrets, Marama est n’est pas vraiment un film gothique, même s’il bénéficie d’une réalisation soignée et élégante et d’une photographie à l’avenant. C’est avant tout un brûlot historique qui pointe du doigt les dérives de la colonisation et plus spécifiquement l’appropriation des femmes maoris et de leur culture (ici, les rites funéraires). Le film est particulièrement violent dans la représentation de la bourgeoisie anglaise victorienne, qui sous un masque de convenances peut virer à tout moment en une meute grotesque incapable de contrôler ses instincts de destruction. Dans cette représentation totale, le pire de tous est celui qui reste en façade le plus civilisé. Au théâtre anglais, Taratoa Stoppard oppose la vérité des maoris. Il semble avoir fouillé son sujet et rendu fidèlement les éléments de cette culture. Dans un récit enchevêtré de visions et de révélations, il nous mène par la main vers un final brutal, mais libérateur pour l’héroïne. Màrama est un bon premier film, classique mais original dans son sujet, qui n’aurait pas volé un prix. Il repart bredouille, mais il faudra suivre son réalisateur.
Sombres Présages

Ce FEFFS 2025 nous a sélectionné une rétro du meilleur des films sur le totalitarisme qui incluait notamment le 1984 de Michael Rachtford et le film d’animation La Ferme des Animaux de 1954. Le documentaire Orwell : 2+2 = 5 de Raoul Peck, à sortir prochainement, était une aubaine pour apporter le point final à cette rétrospective, car le grand écrivain anglais reste celui qui a su formaliser de la façon la plus lucide les mécanismes des régimes autoritaires. Dans son documentaire, Raoul Peck aborde bien sûr l’écriture de 1984 et les derniers mois de la vie de George Orwell, en parallèle à des éléments de sa vie qui expliquent son engagement : Son enfance en Inde dans une classe supérieure désargentée mais conservatrice, la honte de travailler pour le gouvernement, son engagement durant la guerre d’Espagne, sa désillusion politique (…). Mais ces éléments récurrents ne servent qu’à ponctuer la véritable vocation du documentaire, qui est de tisser des liens entre l’actualité récente et les concepts développés dans 1984.

Narré par la voix de Damian Lewis (Homeland) en George Orwell, Orwell : 2+2 = 5 trouve sa structure dans les slogans du parti : « La Guerre, c’est la paix », « La Liberté c’est l’esclavage », « L’ignorance c’est la force », les concepts de novlangue, la surveillance, la minute de la Haine (…) pour montrer leur vérité dans l’Histoire (particulièrement au milieu du XXe, lorsque l’ouvrage fut écrit) et leur résurgence à notre époque. Le fameux 2+2 = 5 , la destruction de la vérité objective pour imposer la vérité de Big Brother, étant le but suprême de toute cette horrible comédie. Il n’y a pas besoin de plus d’images pour nous faire prendre conscience que les conditions actuelles sont de plus en plus propices à ce que notre monde devienne un patchwork de régimes totalitaires qui annihilent nos libertés et définissent leur propre vérité. Ce documentaire forme une synthèse solide de tous les ressentis que pourraient avoir les lecteurs du livre. On a parfois l’impression d’être à un concert de Massive Attack, tant l’effet cumulatif est déprimant, mais Raoul Peck prend habilement le contrepoids pour revenir de temps à autre aux épisodes plus intimes de la vie de l’auteur. Orwell : 2+2 = 5 est bien le film le plus horrible de cette édition. Il montre à quel point il y’a urgence à enseigner 1984 dans toutes les écoles.
Cauchemar Lycéen
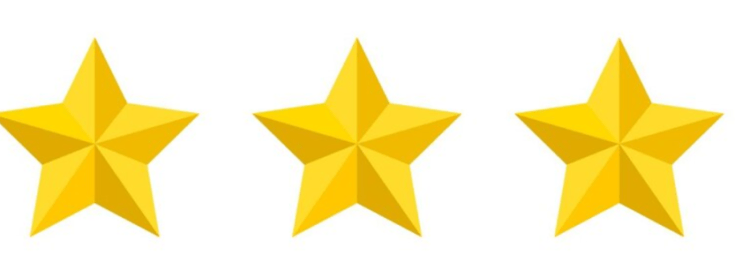
Le sympathique New Group suit une jeune lycéenne timide, Ai, qui subit de front un trauma familial. Un jour, certains de ces camarades se mettent à former une pyramide humaine. Bientôt, les professeurs et le principal forcent les autres élèves à se joindre à la pyramide, qui grossit et lobotomise ceux qu’elle a agrégé. Ai et un nouvel élève très individualiste, Yu refusent de se soumettre. Ils deviennent vite des parias traqués par ceux qui sont entrés dans l’édifice humain. Lorsque le phénomène s’étend à la ville, ils n’ont plus d’autre choix que de survivre.

Un peu à la façon d’un Junji Ito, le réalisateur mise tout sur l’évènement absurde et malsain que constitue sa pyramide humaine, instillant une étrangeté dans le décor familier d’un lycée. On connaît la chanson des individus luttant contre une conscience collective qui assimiler tout un chacun, mais New Group n’a rien d’un autre Body Snatchers dans un lycée. Son horreur est moins agressive, plus abstraite et un peu plus haute en couleur (voir la sympathique résolution finale). Elle pourrait provenir d’un autre monde ou être tout à fait terrestre, comme un évènement viral provoqué par une vidéo sur un réseau social, ou par une organisation souhaitant uniformiser la population. New Group est un bon film qui parvient à rendre attachants ses deux héros et à divertir sur toute sa durée. S’il n’a pas volé sa mention spéciale du jury, on aurait peut-être voulu qu’il soit un peu plus méchant.
Alien Theory

Yórgos Lánthimos n’en finit pas de surprendre par sa capacité à assimiler n’importe quel sujet et à le transformer en quelque chose de singulier et puissant, et parfaitement équilibré. Le dernier en date est ce remake du savoureux film coréen Save the Green Planet ! (2003) confié par Ari Aster aux bons soins du réalisateur de Poor Things et The Lobster. Présenté en avant-première en clôture du festival, Bugonia est la quatrième collaboration entre Yórgos Lánthimos et Emma Stone, qui interprète ici la PDG d’une entreprise enlevée par deux ravisseurs aux intentions étranges. Le chef de l’opération, Teddy Gatz, pense qu’elle est une extraterrestre venue d’Andromède qui a l’intention de détruire les abeilles, et a fortiori la terre et ils comptent bien négocier par la force auprès des instances aliens. Retenue dans le sous-sol de l’appartement, la caricature de PDG bienveillante doit composer avec les thèses étranges de ceux qui apparaissent comme des conspirationnistes. Mais les motivations de Teddy sont aussi familiales car sa mère est entre la vie et la mort à cause de l’entreprise de Michelle. Une guerre des nerfs se constitue entre les deux parties alors que Teddy refuse de discuter le fait que Michelle n’est pas une alien.

Bugonia reprend le postulat du film d’origine pour le reconfigurer à l’aune des grandes problèmes insolubles actuels : Le complotisme rampant, le sacrifice de la planète sur l’autel du capitalisme, l’impossibilité d’un dialogue entre des extrêmes polarisés et l’anxiété qui contamine la bande son de façon tapageuse. Il arrose le tout de son humour noir habituel qui fait des merveilles pour donner à respirer un huis- clos très tendu. Comme c’était le cas sur Poor Things, l’absurde et l’ironie laissent parfois la place à une empathie subite qui gravite d’un camp à l’autre. La mise en scène est opérée au cordeau. Emma Stone s’épanouit tout autant que pour ses précédents rôles dans la galaxie Lánthimos (sans égaler sa prestation dans Poor Things, il faut le dire), mais c’est Jesse Plemmons qui étonne le plus. Implacable et ambivalent, il parvient à rendre toute la complexité d’un personnage qui semble à première vue une caricature de conspirationniste. Nous ne dévoilerons pas qui d’Emma Stone ou des abeilles s’en sort car il est mieux de préserver la succession de surprises que nous réserve le réalisateur, quitte à visionner ensuite le film original. Le voyage est une nouvelle fois comique, dramatique, absurde, désespéré et pittoresque, avec une dernière séquence qui vous laissera bouche bée. Il vous attend en salles le 26 novembre prochain.
PALMARES
Octopus d’or du meilleur long métrage international – Good Boy de Ben Leonberg
Mention spéciale du Jury – New Group de Yûta Shimotsu
Prix du Public – The Holy Boy de Paolo Strippoli
Méliès d’argent du meilleur long métrage européen – The Holy Boy de Paolo Strippoli
Grand Prix Crossovers – Luger de Bruno Martín
Mention spéciale du Jury Crossovers – The Forbidden City de Gabriele Mainetti
Cigogne d’or du meilleur film d’animation – Arco de Ugo Bienvenu
Mention spéciale du Jury Animation – Heart of Darkness de Rogério Nunes


Laisser un commentaire